Weekly Shaarli
Week 33 (August 14, 2023)

Un morceau des Pink Floyd reconstitué par une IA à partir d’ondes cérébrales
L’étude d’enregistrements de l’activité cérébrale a permis de révéler quelles régions du cerveau étaient impliquées dans le traitement de la musique. Mais surtout, l’exploitation de ces données par une intelligence artificielle a permis de reconstruire une célèbre chanson du groupe britannique Pink Floyd.
Publié hier à 16h31 Lecture 2 min.
“Des scientifiques ont reconstitué Another Brick in The Wall, des Pink Floyd, en scrutant les ondes cérébrales d’auditeurs de la chanson : c’est la première fois qu’un titre est décodé de manière reconnaissable à partir des enregistrements de l’activité cérébrale”, rapporte The Guardian.
Le quotidien britannique se fait l’écho d’une étude publiée le 15 août dans Plos Biology, pour laquelle des chercheurs ont étudié les signaux cérébraux de 29 personnes captés par des électrodes implantées à la surface de leur cortex, dans le cadre d’un traitement contre l’épilepsie. Ces enregistrements ont été réalisés alors qu’on faisait écouter la chanson des Pink Floyd aux patients.
La comparaison des signaux émis par les cerveaux avec les ondes audio correspondant au titre original a permis aux chercheurs d’identifier quelles électrodes étaient fortement liées à la mélodie, à sa hauteur, à l’harmonie et au rythme de la chanson. Puis ils ont entraîné un programme d’intelligence artificielle (IA) à repérer les liens entre l’activité cérébrale et les composants musicaux, en excluant un segment de quinze secondes de la chanson.
Cette IA ainsi formée a généré le bout manquant uniquement à partir de l’activité cérébrale des participants. “Le spectrogramme – une visualisation des ondes audio – du bout généré par l’IA était similaire à 43 % au vrai segment de la chanson”, indique New Scientist.
“Tour de force technique”
Interrogé par Science, Robert Zatorre, neuroscientifique à l’université McGill, au Canada, qui n’a pas participé à l’étude, estime que “cette reconstitution est un ‘tour de force technique’ qui donne un nouvel aperçu sur la façon dont le cerveau perçoit la musique”.
En outre, précise la revue scientifique, la méthode développée par l’équipe “a permis d’identifier une nouvelle région cérébrale qui participe à la perception du rythme musical, comme la guitare vrombissante d’Another Brick in The Wall (Part 1)”. Elle ajoute :
“Ces travaux confirment aussi que la perception de la musique, contrairement au traitement ordinaire du langage, mobilise les deux hémisphères du cerveau.”
Ludovic Bellier, neuroscientifique et chercheur en informatique à l’université de Californie Berkeley, premier auteur de l’étude “espère que ces recherches pourront un jour être utiles aux patients qui ont des difficultés d’élocution à la suite d’un AVC, de blessures ou de maladies dégénératives telles que la sclérose latérale amyotrophique”, indique Science.
Reste que, pointe dans New Scientist Robert Knight, de l’université de Californie, qui a piloté les travaux, pour le moment “la nature invasive des implants cérébraux rend peu probable l’utilisation de cette procédure pour des applications non cliniques”. Les progrès techniques dans le domaine de l’étude du cerveau laissent cependant penser que ce genre d’enregistrement pourra un jour se faire sans recourir à la chirurgie, peut-être en utilisant des électrodes fixées au cuir chevelu.
Par ailleurs, une autre équipe a récemment utilisé l’IA pour générer des extraits de chansons à partir de signaux cérébraux enregistrés à l’aide d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Interrogée par New Scientist ; la juriste Jennifer Maisel, du cabinet Rothwell Figg, à Washington, estime qu’“à mesure que progresse la technologie, la recréation de chansons grâce à des IA et à partir de l’activité cérébrale pourrait soulever des questions de droit d’auteur, selon le degré de similarité entre la reconstitution et le titre original”.
Et sans passer par la reproduction de tubes existants, certains imaginent déjà que l’IA pourra être utilisée pour composer de la musique que les gens imaginent à partir de l’exploitation de leurs signaux cérébraux. Mais ce n’est pas encore pour demain.
La vidéo en anglais ci-dessous permet d’écouter les deux versions – l’originale et la reconstruite – d’Another Brick in The Wall (Part 1).
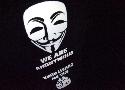
De quoi « V for Vendetta » est-il le masque ?
Par William Audureau et Damien Leloup Publié le 16 mars 2016 à 20h24, modifié le 17 mars 2016 à 17h54
Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.
Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.
En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».
AnalyseDix ans après sa sortie, le film de superhéros anarchiste a prêté son visage à toute une génération de sympathisants.
Medek, 16 ans, interrogé en novembre dernier dans les allées de la Paris Games Week, est vêtu d’un t-shirt arborant le masque de Guy Fawkes. Il le porte « parce que c’est stylé, on porte ce t-shirt comme on pourrait porter un t-shirt Nike ». Il connaît le film V for Vendetta, « un film sur un rebelle », mais cela ne l’inspire pas plus que cela. A ses côtés, Hubert, 15 ans, lui aussi fan de l’objet, n’a pas trop d’explication sur son attachement à ce masque et la portée du film. Il admet volontiers un côté politique, mais sans particulièrement y prêter attention.
Il y a encore cinq ans, le masque de Guy Fawkes, avec son sourire figé, insolent et insondable, était le symbole de toutes les luttes. Indignés, Occupy Wall Street, jeunes du printemps arabe, militants anti-G8 et G20, sans oublier Anonymous, tous les mouvements de contestation l’arboraient. Mais depuis qu’il a été popularisé par le film V for Vendetta, qui fête ses dix ans aujourd’hui, le costume est aussi devenu un code populaire, presque une marque, indice public sinon d’une revendication, du moins d’une insoumission affichée.
Comme le comics dont il est l’adaptation, V for Vendetta est un film politique : il raconte le dernier coup d’éclat de V, superhéros anarchiste vengeur, qui à la manière de Guy Fawkes, instigateur au XVIe siècle d’une tentative d’attentat ratée contre le Parlement anglais, cherche à mettre à feu et à sang une Angleterre dystopique aux mains d’un régime fasciste. Sur le film, de nombreuses analyses ont été rédigées, tantôt pour en saluer l’indocilité joyeuse et enragée, tantôt pour épingler son manichéisme et, ironiquement, son esthétique fascisante.
Le masque que porte le héros est tout simplement tombé dans la culture populaire, grâce au marketing du film et à son adoption sans réserve par les sympathisants du mouvement Anonymous. Ce dernier en a fait le symbole de l’indivisibilité et de la détermination vengeresse du peuple, face à ce qu’il identifie comme des puissances corrompues ou oppressantes.
« Ce masque appartient à tout le monde, il est dans le domaine public : libre à chacun d’en faire ce qu’il veut », se félicite son concepteur, David Lloyd, ravi qu’il ait été repris par des mouvements contestataires.
« V pour Vendetta est l’histoire d’une résistance contre l’oppression et la tyrannie. Partout où le masque a été employé jusque-là, ce le fut dans ce même but et dans ce même esprit. Pour moi, son utilisation est conforme au message véhiculé dans notre œuvre. »
Lire l’entretien avec David Lloyd : « Le masque de V appartient à tout le monde »
Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.
Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.
En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».
Time Warner et usines au Brésil
Pourtant, le masque omniprésent n’est pas vraiment dans le domaine public. Si son créateur a donné sa bénédiction à toutes les personnes qui souhaitent se l’approprier, les droits sur l’objet appartiennent en réalité à Time Warner, producteur du film de 2005. Ironiquement, une multinationale du divertissement touche donc une commission sur chaque vente des masques « officiels », utilisés notamment par des militants qui dénoncent la mainmise de grandes entreprises sur la création et la liberté d’expression... D’autant plus que certains des masques sont fabriqués au Brésil ou en Chine, dans des usines où les conditions de travail sont plus que difficiles. La publication, en 2013, de photos prises dans une usine près de Rio, avait poussé une partie des militants d’Anonymous à s’interroger sur leur utilisation du masque.
Peut-on pour autant en conclure que ce masque est une coquille vide et hypocrite, une version modernisée du t-shirt à l’effigie de Che Guevara ? Comme le t-shirt rouge de Guevara, le masque de Guy Fawkes est porté aussi bien par des personnes qui le trouvent « stylé » que par des militants qui choisissent de le revêtir parce qu’il porte une signification politique. Comme le film V pour Vendetta, le masque mêle dans un même objet consumérisme grand public, effet de mode et engagement.
Le masque continue d’ailleurs d’inspirer la peur de certains régimes autoritaires : en 2013, bien après le printemps arabe, les gouvernements du Bahrein et d’Arabie Saoudite l’ont déclaré illégal, et ont interdit son importation. Le gouvernement d’Arabie saoudite estimait alors que ce morceau de plastique « diffuse une culture de violence » et « encourage les jeunes à ne pas respecter les forces de sécurité et à répandre le chaos dans la société ».
Anonymat, Anonymous et action collective
Pourquoi ce masque inquiète-t-il autant certains gouvernements ? Pour ce qu’il représente, d’abord, mais aussi pour ce dont il est la fuite : le rejet d’une société orwelienne où forces médiatiques et politiques contrôleraient la vie de chaque individu.
Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.
Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.
En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».
Né en bonne partie sur le forum 4chan, temple de l’anonymat et de l’inconséquence en ligne, le mouvement Anonymous n’a pas adopté un masque comme symbole commun par hasard : l’émergence médiatique du mouvement est strictement contemporaine de l’explosion de Facebook et de l’autofiction en ligne. Comme le relève sur son site l’anthropologue Gabriella Coleman, auteure de l’étude Anonymous. Hacker, activiste, faussaire, mouchard, lanceur d’alerte (éditions Lux) :
« Alors que les Anonymous doivent taire leur identité et cacher leurs actions, le groupe exige la transparence du gouvernement et des grands acteurs. Aux yeux de Mark Zuckerberg, de Facebook, la transparence consiste à partager en permanence des informations personnelles ; il est allé jusqu’à proclamer la mort de la vie privée. Anonymous offre une antithèse provoquante à la logique de l’autopublication constante et de la quête de gloire. »
Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.
Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.
En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».
A travers le masque de Fawkes, le mouvement Anonymous redonne également corps à l’idée d’une force collective qui ne serait pas l’addition de ses composantes, mais leur multiplication, à la manière de ce que Musil évoquait, dans L’homme sans qualités (éditions Point), comme « l’aurore d’un nouvel héroïsme, énorme et collectif, à l’exemple des fourmis ».
Le visage rieur de l’anarchiste terroriste prolonge, comme le remarque Gabriella Coleman, les intuitions de l’historien Michel de Certeau. Quelques années avant la publication du comics original de V for Vendetta, dans L’invention du quotidien, il suggérait l’idée d’un « anonyme rieur », « sage et fou, lucide et dérisoire », navigant dans les interstices de la collectivité, qui résisterait aux discours généralisants, aux lectures systémiques, à toute analyse figée, et ramènerait toute construction intellectuelle à l’inéluctabilité de la mort.
David Lloyd dit-il autre chose, lorsqu’il justifie l’étrange rictus de son masque ? « D’un côté, il n’y a rien de plus effrayant que de voir quelqu’un vous tuer tout en souriant. De l’autre, un sourire est par définition une marque d’optimisme. »

Pour gagner de la place, Pékin expérimente les cimetières numériques
Publié hier à 14h54 Lecture 1 min.
Face au vieillissement rapide de la population et à la rareté des terrains, la capitale chinoise expérimente actuellement la mise en place d’espaces funéraires dotés d’écrans qui diffusent les photos des défunts, à la place des tombes.
Lorsqu’une personne meurt à Pékin, son corps est généralement incinéré et ses cendres sont enterrées sous une pierre tombale dans l’un des cimetières publics de la ville. Pour rendre hommage aux défunts, la famille et les amis se rassemblent sur le site pour allumer des bougies et brûler de l’encens.
Mais Zhang Yin en a décidé autrement. Les cendres de sa grand-mère ont été conservées dans un compartiment installé dans une vaste salle du cimetière de Taiziyu, à Pékin, un peu comme un coffre-fort dans une banque. Sur la porte, un écran est installé et diffuse des photos et vidéos de la défunte.
“Cette solution permet d’économiser de l’espace et s’avère moins onéreuse qu’une sépulture classique. Par ailleurs, de plus en plus de familles chinoises souhaitent offrir à leurs proches des funérailles plus personnalisées, et ces dispositifs collent parfaitement avec cette tendance”, estime Bloomberg.
Nouveaux modes de gestion des cimetières
En Chine, les autorités locales et les pompes funèbres expérimentent de “nouveaux modes de gestion des cimetières pour faire face à la pénurie de terrain en zone urbaine et au vieillissement rapide de la population”, rapporte le média en ligne. Selon le Bureau national des statistiques, le nombre annuel de décès a atteint 10,4 millions en 2022, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à 2016.
Le Conseil d’État a déclaré que Pékin s’efforcerait de réduire la superficie totale occupée par les cimetières publics à environ 70 % de sa superficie actuelle d’ici à 2035, et le pays a encouragé d’autres formes de sépulture pour économiser de l’espace.
De telles avancées technologiques attirent les jeunes vers ce secteur. Au cours des derniers mois, le hashtag “les formations aux métiers du funéraire affichent un taux d’embauche à la sortie de 100 %” sur Weibo a été consulté 200 millions de fois. Les perspectives d’emploi ont entraîné une augmentation du nombre d’inscriptions dans les formations liées au secteur funéraire dans certains établissements d’enseignement supérieur, à un moment où le taux de chômage des jeunes atteint un niveau record en Chine.
Dans le même temps, le plus grand défi auquel sont confrontés les “cybercimetières”, selon les entreprises de pompes funèbres qui sont cités par le Bloomberg, est la perception traditionnelle chinoise de la mort. Historiquement, les Chinois ont toujours été moins ouverts aux discussions sur la mort que les Occidentaux. Contrairement à la nouvelle génération chinoise, qui “n’accorde pas vraiment d’importance au fait d’être enterré, ni au feng shui”, un ensemble de normes de la tradition chinoise pour l’aménagement du foyer.

Les voyageurs statiques des hôtels-clubs
Publié: 13 août 2023, 15:31 CEST
Des centaines de milliers d’Européens partent régulièrement en vacances en hôtels-clubs. Le célèbre club Méditerranée a inventé dans les années 1950 un nouveau type de vacances, en même temps qu’il a produit indirectement une espèce nouvelle de touristes : les « anti-voyageurs », ou voyageurs statiques. En tout cas, les « hôtels-clubs » façon « Club Med » (beaucoup d’autres acteurs se partagent ce marché gigantesque désormais) connaissent un succès qui ne se dément pas.
L’idée originelle était de démocratiser les vacances, d’offrir la possibilité au plus grand nombre « de partir au soleil » à coût réduit et « à la bonne franquette ». Il y avait dans le principe des premiers « clubs » l’idée de proposer des vacances accessibles à tous. Les fondateurs des « clubs de vacances », les années suivant la Seconde Guerre mondiale, sont issus d’une nouvelle bourgeoisie urbaine et sportive, attachée à l’hédonisme et à la quête de bien-être qu’ils ont connu dans les auberges de jeunesse.
L’historien Marc Boyer, dans son ouvrage Le tourisme (1972) indique : « le [village de vacances est] un centre autonome constitué par des installations de type pavillonnaire en matériaux légers, destiné à assurer des séjours de vacances de plein air selon un prix forfaitaire comportant l’usage d’installations sportives et de distractions collectives ».
Dans la lignée des études des imaginaires du tourisme chers à Rachid Amirou et de « l’anthropologie des mondes contemporains » de Marc Augé, je propose ici des clefs de compréhension du succès de ces villages repliés sur eux-mêmes pour vacanciers sédentaires.
Un exotisme de pacotille
Parmi les un peu plus de 50 % de Français partant en vacances, ils sont cet été encore très nombreux à opter pour ces « villages vacances » pour touristes sédentaires. Et on connaît les transhumances massives des vacanciers de l’Europe du Nord vers la Grèce ou l’Espagne, dont certaines côtes sont monopolisées par ces hôtels-clubs rassemblant simultanément des centaines voire des milliers de personnes.
Ce mode de congés communautaires n’a ni l’estampille plutôt populaire des campings, ni la distance feutrée des petits hôtels, ou le charme feutré et la convivialité des chambres d’hôtes et autres bed and breakfast. Enfin, on n’est pas, comme dans des airbnb, autonome chez l’habitant, avec la charge de la restauration et du ménage. En hôtels-clubs, ce sont des vacances d’un autre genre, exotiques, humides et ensoleillées. Quitte à ne pas être trop exigeant sur cet exotisme, sublimé par le papier glacé des catalogues ou dans les vidéos postées en ligne vantant un bonheur radieux, entre piscine turquoise et soleil éclatant, paillotes exotiques et bar convivial.
[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
Ces villages de vacances, aux mains de quelques grands groupes, s’étendent à perte de vue dans certaines zones et ils quadrillent les côtes méditerranéennes et caribéennes, contribuant à bétonner massivement les littoraux, de l’Espagne au Maroc, de la Grèce à la Turquie, de la Tunisie à la République dominicaine, ainsi que de certains pays africains. Les vacances statiques qu’ils proposent, rassemblant ce que l’on pourrait appeler des « anti-voyageurs », connaissent en règle générale pour principale aventure les turbulences des vols charters aux horaires aléatoires. Mais dès qu’on est arrivé, on ne sortira presque plus de sa petite bulle de chlore et de soleil. Tout est fait pour favoriser le double principe mental de la régression, et de la « suspension » des règles de vie ordinaires.
Une bulle régressive
Des vacances en « hôtels-clubs », il y en a bien sûr pour tous les budgets, des cases intimistes sur les plages immaculées des Bahamas ou de l’île Maurice aux villages verticaux pour touristes d’Europe du Nord de la Costa Blanca, souvenirs d’années 1970 où l’on « bétonnait » sans grand souci environnemental. Et ces disparités fondées sur les stratifications socioéconomiques et socioculturelles doivent nécessairement être présentes à l’esprit. L’analyse se centre ici sur les clubs « milieu de gamme ».
Ces clubs sont fermés (on en sort peu, mais on peut en sortir, en revanche les « extérieurs » n’y ont pas accès) et gardés, les repas se prennent en commun par la force des choses (sur le principe du buffet à volonté), et ils sont placés sous l’autorité souriante et la convivialité ostentatoire d’un chef de camp qui en principe, tutoie tout le monde et plaisante volontiers dans un sabir international. Et puis des « GO » (« gentils organisateurs », modèle impulsé par le Club Med) en uniforme estival, arpentent en permanence le club, proposant de participer aux activités qu’ils organisent et animent, tout en « ambiançant » les relations, ce qui n’est jamais gagné…
Les hôtels-clubs doivent leur succès à un principe fort : le all inclusive, sur la base d’une semaine. Le prix payé avant le départ prend tout en compte : le vol, le séjour, les activités de loisirs, la pension complète et le « snacking ». Et si certains groupes proposent des séjours de luxe à des tarifs conséquents pour cibler une clientèle haut de gamme, la plupart cassent les prix. L’axiome pragmatique fondant le principe de ces hôtels est qu’il faut « remplir pour rentabiliser ».
Cependant, tout est pensé pour instaurer une régression mentale et physique, assez infantilisante dans l’esprit ; Ceci n’est pas un jugement de valeur mais un constat étayé. Déjà, on ne touchera plus d’argent durant la semaine, car le principe du bracelet que chaque vacancier porte au poignet (avec ses codes-couleur et les droits et privilèges afférents) fait que le all inclusive commence par cette suspension de toute transaction économique. On mange, on boit, on « snacke » à volonté, à n’importe quelle heure, sans limitation, et sans calcul ni transaction, aucun prix n’est affiché. Les règles économiques usuelles de la vie quotidienne – choisir, acheter, payer – sont annihilées : on peut prendre tout ce qu’on veut, et « gratuitement ». Le prix et la transaction se situent ailleurs, bien sûr. Mais ils sont là gommés ; suspension et régression, encore…
À l’avenant, en hôtel-club, il y a peu de motivation culturelle : la plupart des vacanciers se limiteront à la visite groupée et au pas de course du village le plus proche, avec pour objectif touristique le souk, le « petit port de pêche » ou le « marché traditionnel ». Là, c’est souvent un choc inévitable, entre ceux dont on pense qu’ils sont très riches, et ceux dont on sait qu’ils sont très pauvres. Reste le frisson du marchandage de babioles ethniques qui caricaturent les traits de l’exoticité. On a ici en tête les images et l’imaginaire de la place Jemaa El Fna de Marrakech. Après ce choc, cette explosion de couleurs, d’odeurs et de saveurs – et ces frissons, on réintègrera l’insularité rassurante du club. La sortie a été organisée, d’ailleurs, par le club, avec ses navettes à heures fixes. On pourrait éventuellement faire une excursion d’une journée, mais parfaitement balisée, avec les partenaires du voyagiste.
Une topographie particulière
Pendant quelques jours, la vie est organisée autour de trois pôles, qui, au gré des heures, aimantent les centaines de touristes : la piscine, le buffet, la scène de spectacle.
La piscine, d’abord. Là, on est loin des bassins municipaux, spartiates et rectangulaires. En hôtel-club, elle est immense, s’étendant, toute en volutes, au centre du club. Elle n’est en fait jamais tout à fait une piscine – on n’y nage pas vraiment – mais une pataugeoire géante, aux formes ovoïdes, à l’eau luminescente. On a pied partout, et déjà pour les besoins des chorégraphies bruyantes de la gym aquatique. La piscine est en fait là un lieu fœtal dans l’esprit, où l’on flotte et détrempe mollement. Des bars sont parfois installés au milieu de l’eau, où l’on vient « à la source matricielle » snacker et trinquer, tout en restant dans l’eau. L’eau est chaude, les couleurs flashy. Ces piscines, bordées de centaines de transats en plastique blanc, objets de toutes convoitises et de stratégies d’appropriation donnant parfois lieu à des tensions : « je pose ma serviette, c’est le mien pour la journée », sont la promesse et, par anticipation, le souvenir de ces vacances, leur eau turquoise ouvrant sur des imaginaires de lagons tahitiens. Et puis ceci est désormais très « instagrammable ».
Puis les buffets, derrière lesquels s’affaire une foule anonyme et appliquée d’employés locaux, tout de blanc vêtus. Les buffets, et leurs amoncellements gargantuesques de plats standard – riz-pilaf, frites, pizzas, couscous, hamburgers, pâtes à toutes les sauces, desserts industriels, fruits… Bref, une cuisine rebaptisée « internationale », présentée en compositions arcimboldesques, et qui se donnent à profusion.
Le système, qui réinvestit les mythes de Cocagne ou de la Corne d’abondance, est ainsi fait – tout est à volonté – qu’on en prend presque toujours « trop ». À la fin du repas, les assiettes contiennent souvent un mixte incertain de matières et de couleurs qui partira au rebut, confirmant au passage le « péché originel » du tourisme de masse : consommer en surabondance et générer du gaspillage dans des zones de pénurie. À l’avenant, les jardins-oasis des villages de vacances, dont la luxuriance ordonnée narguent les zones quasi-désertiques alentour, pour des clichés d’Eden à bas coût.
Autour de la piscine ou sur la plage (quand le club est sur le littoral, cette place est alors viabilisée et souvent gardée), on bronze des heures, crème écran total sur les épaules et casque sur les oreilles, afin d’arborer au retour la preuve épidermique que l’on rentre bien de vacances. Se baigner dans la mer n’est pas une obligation, et beaucoup restent du côté de la piscine. On perçoit les oppositions symboliques à l’œuvre, nature/civilisation.
La sociabilité caractérisant ces clubs est paradoxale : on ignore la plupart des autres vacanciers – poliment ou pas – lorsqu’il faut jouer des coudes aux heures de pointe au buffet, ou s’approprier un transat bien placé. Et une ambiance « sociofuge » prévaut, donnant à penser qu’on est là « seuls ensemble ». On passe son temps à « s’ignorer poliment » (Yves Winkin). Et paradoxalement, on se liera souvent avec des personnes rencontrées par hasard (voisins de bronzing ou de tablée) qui vont devenir les « meilleurs amis de vacances », avec qui on discutera durant quelques jours de tout et de rien, et desquels on gardera les coordonnées. Se rappellera-t-on, se reverra-t-on, une fois la parenthèse enchantée refermée, et de retour chez soi ? Pas sûr…
La scène, enfin, face au bar, voit alternativement les uns se produire en public, et les autres se donner en spectacle. Dès que la nuit tombe, et avant le night-club, beaucoup des vacanciers se retrouvent devant la scène, et même sur elle. D’abord, il y aura les saynètes des animateurs, plus ou moins prévisibles et réussis (clowns, cabaret, danse). Dans certains clubs, c’est vraiment professionnel, et dans d’autres, c’est beaucoup plus amateur. Puis les planches et les sunlights seront offerts aux vacanciers, pour des séquences incertaines pourtant immortalisées par les smarphones : karaoké, roue de la fortune, tests de culture générale et autres adaptations des jeux télévisuels.
« La vacance des valeurs »
Les hôtels-clubs bouclent la boucle du tourisme de masse. Ils brassent les gens et les genres. Ils offrent une détente assurée à quelques heures de vol, derrière des enclos gardant les touristes de ce qu’est l’immédiat extérieur du club, et qu’on discerne, lorsqu’on arpente les coursives des chambres situées en étage. L’idée qui semble prévaloir est celle de l’oasis. Mais cela demande un travail de dénégation de la part des vacanciers, qui doivent ignorer la différence immense caractérisant le dedans – isolat de luxe, de prévisibilité organisée, de profusion obligée – et la « vraie vie » de l’extérieur, avec des logiques qui sont à mille lieues de celle du club vacances.
À ce titre, on pourrait aussi considérer que ces vacances seront de moins en moins compatibles avec les préoccupations écoresponsables saillantes et le souci des cultures locales, et la rencontre interculturelle.
Ces clubs offrent des vacances amnésiques, dont on ramène des sensations interchangeables : le soleil qui brûle, les cocktails sucrés, les corps en uniforme estival (tee-shirts, shorts, maillots de bain) qui se croisent, les airs disco et la musique techno servant de toile de fond sonores ; ces pantomimes tribales orchestrées par des animateurs à la jovialité permanente, et la convivialité un rien forcée caractérisant les échanges et présidant aux interactions.
Une mise en perspective anthropologique amènerait à considérer qu’ils sont carnavalesques dans l’esprit, procédant à une série d’inversions et de suspensions, instaurant un temps festif, où les statuts sont aplanis et où les identités sont ramenées à un prénom, où les plaisirs vont prévaloir, où l’on se permet ce qu’on ne s’autorise pas forcément en temps ordinaire.
Mais de même, partant de la clôture et de la suspension qui les caractérisent, un parallèle peut être établi avec le succès des croisières : une croisière, c’est en fait un hôtel-club flottant. Et cet hôtel-club peut aussi être considéré comme un bateau de croisière immobile, en rade au bord de la mer. Il s’agit d’univers fermés, avec leur économie symbolique, leurs règles spécifiques, leur finalité, qui est presque la même.
En hôtels-clubs, on s’adonne à des plaisirs régressifs loin d’une actualité anxiogène et morose. Et ils rappellent la fulgurance d’Edgar Morin : « la valeur des vacances, c’est la vacance des valeurs ».
L’auteur remercie Yves Winkin et Elodie Mielczareck pour leur lecture de cet article et leurs commentaires

‘Everything you’ve been told is a lie!’ Inside the wellness-to-fascism pipeline
James Ball Wed 2 Aug 2023 14.00 BST
One minute you’re doing the downward dog, the next you’re listening to conspiracy theories about Covid or the new world order. How did the desire to look after yourself become so toxic?
Jane – not her real name – is nervous about speaking to me. She has asked that I don’t identify her or the small, south-coast Devon town in which she lives. “I’m feeling disloyal, because I’m talking about people I’ve known for 30 to 40 years,” she says.
Jane isn’t trying to blow the whistle on government corruption or organised crime: she wants to tell me about her old meditation group. The group had met happily for decades, she says, aligned around a shared interest in topics including “environmental issues, spiritual issues and alternative health”. It included several people whom Jane considered close friends, and she thought they were all on the same page. Then Covid came.
Jane spent most of the first Covid lockdowns in London. During that time, she caught Covid and was hospitalised, and it was then that she realised something significant had changed: a friend from the group got in touch while she was on the ward. “I had somebody I considered a real best friend of mine on the phone telling me, no, I ‘didn’t have Covid’,” she says. “She was absolutely adamant. And I said: ‘Well, why do you think I went into hospital?’”
The friend conceded that Jane was ill, but insisted it must be something other than Covid-19, because Covid wasn’t real. Jane’s hospital stay was thankfully short, but by the time she was sufficiently recovered and restrictions had lifted enough to allow her to rejoin her meditation group, things were very different.
“They have been moving generally to far-right views, bordering on racism, and really pro-Russian views, with the Ukraine war,” she says. “It started very much with health, with ‘Covid doesn’t exist’, anti-lockdown, anti-masks, and it became anti-everything: the BBC lie, don’t listen to them; follow what you see on the internet.”
Things came to a head when one day, before a meditation session – an activity designed to relax the mind and spirit, pushing away all worldly concerns – the group played a conspiratorial video arguing that 15-minute cities and low-traffic zones were part of a global plot. Jane finally gave up.
This apparent radicalisation of a nice, middle-class, hippy-ish group feels as if it should be a one-off, but the reality is very different. The “wellness-to-woo pipeline” – or even “wellness-to-fascism pipeline” – has become a cause of concern to people who study conspiracy theories.
It doesn’t stop with a few videos shared among friends, either. One of the leaders of the German branch of the QAnon movement – a conspiracy founded on the belief that Donald Trump was doing battle with a cabal of Satanic paedophiles led by Hillary Clinton and George Soros, among others – was at first best known as the author of vegan cookbooks. In 2021, Attila Hildmann helped lead a protest that turned violent, with protesters storming the steps of Germany’s parliament. Such was his radicalism in QAnon and online far-right circles that he was under investigation in connection with multiple alleged offences, but he fled Germany for Turkey before he could be arrested.
Similarly, Jacob Chansley, AKA the “QAnon shaman” – one of the most visible faces of the attack on the US Capitol on 6 January 2021, thanks to his face paint and horned headgear – is a practitioner of “shamanic arts” who eats natural and organic food, and has more than once been described as an “ecofascist”.
Thanks to wellness, QAnon is the conspiracy that can draw in the mum who shops at Holland & Barrett and her Andrew Tate-watching teenage son. The QAnon conspiracy is one of the most dangerous in the world, directly linked to attempted insurrections in the US and Germany, and mass shootings in multiple countries – and wellness is helping to fuel it. Something about the strange mixture of mistrust of the mainstream, the intimate nature of the relationship between a therapist, spiritual adviser, or even personal trainer, and their client, combined with the conspiratorial world in which we now live, is giving rise to a new kind of radicalisation. How did we end up here?
There are many people interested in spiritualism, alternative medicine, meditation, or personal training, whose views fall well within the mainstream – and more who, if they have niche views, choose not to share them with their clients. But even a cursory online request about this issue led to me being deluged with responses. Despite most experiences being far less intense than Jane’s, no one wanted to put their name to their story – something about the closeness of wellness interactions makes people loth to commit a “betrayal”, it seems.
One person recounted how her pole-dancing instructor would – while up the pole, hanging on with her legs – explain how the CIA was covering up evidence of aliens, and offer tips on avoiding alien abduction.
“A physiotherapist would tell me, while working on my back with me lying face down, about her weekly ‘meetings’ in London about ‘current affairs’,” another said. “There was a whiff about it, but it was ignorable. Then, the last time I saw her, she muttered darkly about the Rothschilds [a common target of antisemitic conspiracy theories] ‘and people like that’. I didn’t go back.”
Some people’s problems escalated when their personal trainer learned about their work. “I had three successive personal trainers who were anti-vax. One Belgian, two Swiss,” I was told by a British man who has spent most of the past decade working in Europe for the World Economic Forum, which organises the annual summit at Davos for politicians and the world’s elite.
“It was hard because I used to argue with all of them and the Swiss made life very difficult for the unvaccinated, but the Swiss bloke insisted that, with the right mental attitude and exercise, you could defeat any illness. I was always asking what would happen if he got rabies.”
When the trainer found out the man worked for the World Economic Forum, he was immediately cut off.
Other respondents’ stories covered everything from yoga to reiki, weightlifters to alternative dog trainers. The theories they shared ranged from extreme versions of wellness-related conspiracies – about the risks of 5G and wifi, or Microsoft founder Bill Gates plotting with vaccines – to 15-minute cities, paedophile rings and bankers’ conspiracies.
Is there a reason why people under the wellness and fitness umbrella might be prone to being induced into conspiracy? It is not that difficult to imagine why young men hitting the gym might be susceptible to QAnon and its ilk. This group spends a lot of time online, there is a supposed crisis of masculinity manifesting in the “incel” (involuntary celibacy) movement and similar, and numerous rightwing influencers have been targeting this group. Add in a masculine gym culture and a community already keen to look for the “secrets” of getting healthy, and there is a lot for a conspiracy theory to hook itself on to.
What is more interesting, surely, is how women old enough to be these men’s mothers find themselves sucked in by the same rhetoric. These are often people with more life experience, who have completed their education and been working – often for decades – and have apparently functional adult lives. But, as Caroline Criado Perez, author of Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men, observes, the answer may lie in looking at why women turn to wellness and alternative medicine in the first place.
New age and conspiracy theories both see themselves as counter-knowledges challenging received wisdom
“Far too often, we blame women for turning to alternative medicine, painting them as credulous and even dangerous,” she says. “But the blame does not lie with the women – it lies with the gender data gap. Thanks to hundreds of years of treating the male body as the default in medicine, we simply do not know enough about how disease manifests in the female body.”
Women are overwhelmingly more likely than men to suffer from auto-immune disorders, chronic pain and chronic fatigue – and such patients often hit a point at which their doctors tell them there is nothing they can do. The conditions are under-researched and the treatments are often brutal. Is it any surprise that trust in conventional medicine and big pharma is shaken? And is it any surprise that people look for something to fill that void?
Criado Perez says: “If we want to address the trend of women seeking help outside mainstream medicine, it’s not the women we need to fix; it’s mainstream medicine.”
This sense of conspiracies filling a void is an important one. Academic researchers of conspiracy theories have speculated about whether their rise in the 20th century is related to the decline of religion. In a strange way, the idea that a malign cabal is running the world – while far more worrying than a benevolent God – is less scary than the idea that no one is in charge and everything is chaos. People who have a reason to mistrust the mainstream pillars of society – government, doctors, the media, teachers – are more likely to turn to conspiracy theories for explanations as to why the world is like it is.
Peter Knight, professor of American studies at the University of Manchester, who has studied conspiracy theories and their history, notes that the link between alternative therapies and conspiracy is at least a century old, and has been much ignored. “New age and conspiracy theories both see themselves as counter-knowledges that challenge what they see as received wisdom,” he says. “Conspiracy theories provide the missing link, turbo-charging an existing account of what’s happening by claiming that it is not just the result of chance or the unintended consequences of policy choices, but the result of a deliberate, secret plan, whether by big pharma, corrupt scientists, the military-industrial complex or big tech.”
Knight notes an extra factor, though – the wellness pipeline has become a co-dependency. Many far-right or conspiracy sites now fund themselves through supplements or fitness products, usually by hyping how the mainstream doesn’t want the audience to have them.
Alex Jones, the US conspiracist who for a decade claimed the Sandy Hook shootings – which killed 20 children and six adults – were a false-flag operation, had his financial records opened up when he was sued by the families of the victims. During the cases, it emerged he had made a huge amount of money by selling his own branded wellness products.
“Alex Jones perfected the grift of selling snake-oil supplements and prepper kit to the libertarian right wing via his conspiracy theory media channels,” Knight says. “But it was Covid that led to the most direct connections between far-right conspiracism and wellness cultures. The measures introduced to curb the pandemic were viewed as attacks on individual sovereignty, which is the core value of both the wellness and libertarian/‘alt-right’ conspiracy communities.”
The problem is, it rarely stops with libertarians. While they may not recognise it, those drawn in from the left are increasingly ending up in the same place as their rightwing counterparts.
“Although many of the traditional left-leaning alternative health and wellness advocates might reject some of the more racist forms of rightwing conspiracism, they now increasingly share the same online spaces and memes,” he says, before concluding: “They both start from the position that everything we are told is a lie, and the authorities can’t be trusted.”
Society’s discussion of QAnon, anti-vaxxers and other fringe conspiracies is heavily focused on what happens in digital spaces – perhaps too much so, to the exclusion of all else. The solution, though, is unlikely to be microphones in every gym and treatment room, monitoring what gets said to clients. The better question to ask is what has made these practitioners, and all too often their clients, so susceptible to these messages in the first place. For QAnon to be the most convincing answer, what someone has heard before must have been completely unsatisfactory.
Jane has her own theory as to why her wellness group got radicalised and she did not – and it’s one that aligns with concerns from conspiracy experts, too. “I think it’s the isolation,” she concludes, citing lockdown as the catalyst, before noting the irony that conspiracies then kick off a cycle of increasing isolation by forcing believers to reject the wider world. “It becomes very isolating because then their attitude is all: ‘Mainstream media … they lie about everything.’”
The Other Pandemic: How QAnon Contaminated *the World by James Ball is published by Bloomsbury*. To support the Guardian and Observer, order your copy at guardianbookshop.com. Delivery charges may apply